« La pénitence ne devrait jamais être perçue comme une punition mais comme un remède au mal »
Paris Notre-Dame du 23 octobre 2025
Formation, pastorale du Pardon, missionnaires de la Miséricorde… La nouvelle pénitencerie diocésaine, confiée au chanoine Jean-Marc Pimpaneau, a pour mission de remettre le sacrement de réconciliation au cœur de la vie chrétienne. À la veille du lancement des formations destinées aux prêtres, le nouveau responsable détaille les enjeux de ce nouvel élan spirituel pour le diocèse de Paris.

Paris Notre-Dame – Lors de notre précédent entretien [1], vous évoquiez l’établissement de la pénitencerie diocésaine. Elle est désormais effective ; que cela change-t-il concrètement ?
P. Jean-Marc Pimpaneau – Depuis le printemps, une équipe a été instituée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris : trois prêtres missionnaires de la Miséricorde – moi-même, de St-Louis d’Antin (9e), le chanoine Henry de Villefranche, de Notre-Dame de Paris, et le P. Bernard Miclescu, de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (18e) –, le chanoine Francis de Chaignon, professeur et théologien, le chanoine Emmanuel Petit, canoniste, et deux fidèles laïques – Anne Mayol, membre de l’équipe d’Anima Mea, qualifiée sur la question du discernement spirituel, et Priscille Pacton, formée, aux Facultés Loyola Paris, aux problématiques de l’accompagnement. La mise en place de cette pénitencerie diocésaine émane de la Conférence des évêques de France qui, en novembre 2024, a appelé à leur création pour renouveler et démocratiser le sacrement de pénitence et de réconciliation mais aussi pour éviter tout abus de conscience ou sexuel. L’un des rôles de la pénitencerie concerne la formation des prêtres pour aller en ce sens.
P. N.-D. – Justement, trois rencontres trimestrielles de formation seront proposées – la première le 4 novembre. Que vont-elles apporter de plus par rapport à la formation continue déjà proposée aux prêtres ?
J.-M. P. – Cette formation vise spécifiquement la pratique du sacrement de pénitence et de réconciliation. En premier lieu pour que les prêtres consacrent du temps à confesser mais aussi à prêcher sur la confession – ce que la plupart ne font que trop rarement. Il y a un véritable travail à faire pour que celle-ci ne soit jamais perçue comme une « salle de torture », comme le disait le pape François. La confession est le sacrement du Cœur de Jésus pour que les fidèles expérimentent l’amour surabondant de Dieu ! Ces formations visent également à remettre en valeur la pénitence. Non, il se n’agit pas d’une punition mais d’un moyen de progression et de guérison, un peu comme l’ordonnance fournie par un médecin. La pénitence est, en quelque sorte, l’ordonnance du prêtre et peut être discernée avec le fidèle – c’est indiqué noir sur blanc dans le rituel mais très peu de prêtres le font. Rien que cela est un changement complet de vision : la pénitence ne devrait jamais être perçue comme une punition mais comme un remède, un remède au mal, pour réparer ce qui a été abîmé et, surtout, progresser.
P. N.-D. – À qui sont destinées ces formations ?
J.-M. P. – À tous les prêtres en mission dans le diocèse de Paris – à l’exception des nouveaux ordonnés qui, pendant trois ans, ont leur propre formation. Chaque rencontre sera divisée en deux temps : un enseignement de quarante-cinq minutes par le P. Guillaume de Menthière, curé de N.-D.-de-l’Assomption-de-Passy (16e) et auteur du Sacrement de réconciliation (Téqui, 2001), avec qui cette formation a été conçue ; suivi de quarante-cinq minutes d’échanges en petits groupes. Ces rencontres auront lieu à St-Louis-d’Antin sur la base de la formation, déjà existante depuis plusieurs années, des confesseurs de ce lieu.
P. N.-D. – Dans le décret sont aussi évoquées les situations dites « complexes ». De quoi s’agit-il et en quoi cette formation peut-elle aider les prêtres à mieux les accompagner ?
J.-M. P. – À mieux accompagner… et surtout à mieux accueillir les personnes ! Celles qui se trouvent, par exemple, dans des situations de divorce et remariage ou d’homosexualité, qui évoquent leurs addictions ou sont touchées par des troubles psychiques comme la scrupulosité. Comme prêtre, comment réagir ? Certains fidèles ne vont jamais communier, notamment dans les situations d’addiction à la pornographie. Une réflexion doit être mise en place pour que les pénitents ne se découragent pas et puissent communier sans forcément devoir se confesser chaque semaine ! Les prêtres sont parfois démunis face à toutes ces situations. Il est donc important qu’ils puissent avoir des lieux non seulement de dialogue mais aussi de formation. L’objectif de la pénitencerie est de les accompagner pour qu’eux-mêmes puissent mieux célébrer ce sacrement.
P. N.-D. – Des missionnaires de la Miséricorde sont associés à la pénitencerie. Quelle sera concrètement leur mission dans les paroisses ?
J.-M. P. – Venir prêcher, à l’invitation des curés qui le souhaitent, sur la miséricorde et la confession. S’ils ont reçu du pape la possibilité de pardonner les « péchés réservés », ceux liés, notamment, à la profanation des saintes espèces ou à la violation du secret de la confession, les missionnaires de la Miséricorde ont aussi pour vocation de promouvoir le sacrement de pénitence et de réconciliation à une époque où les fidèles le perçoivent trop souvent de manière négative et individualiste. Il n’est pas trop tard pour faire évoluer les choses !
P. N.-D. – Le décret mentionne « la diversité culturelle des confesseurs et des pénitents ». Comment cette réalité influence-t-elle l’approche de la confession à Paris ?
J.-M. P. – Selon les pays, la manière d’aborder le sacrement de la confession est différente… ce qui peut d’ailleurs être une richesse ! Je suis, par exemple, souvent admiratif de la grande exigence des jeunes fidèles africains et de la qualité de leurs confessions. Ils ont un réel sens non seulement de l’amour de Dieu mais aussi de la vérité de leur vie. Par le biais de cette formation proposée par la pénitencerie diocésaine, nous avons aussi à cœur d’aider les prêtres étrangers à se situer dans notre contexte français et européen et à en comprendre les problématiques. La confession est fortement liée à la culture et à l’histoire. Elle a d’ailleurs beaucoup évolué dans le temps parce que notre rapport au péché ou au mal se redéfinit lui-même selon les lieux et les époques. Ceci peut ouvrir de nouvelles perspectives : il est tout à fait possible de faire évoluer la pratique tout en respectant les fondamentaux du sacrement et sans remettre en cause ses quatre piliers (la contrition, la confession, la satisfaction – ou discernement de la pénitence – et l’absolution).
Propos recueillis par Mathilde Rambaud
[1] PND n°2048 du 3 avril 2025.
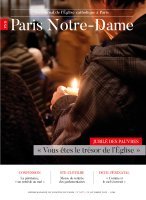
Sommaire
Consulter ce numéro
Acheter ce numéro 1 € en ligne sur les applications iOs et Android






















